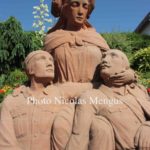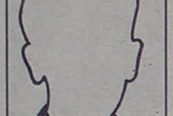Au cours de ma carrière à la Banque, j’ai pu constater que certains collègues, par leurs réflexions, ignoraient totalement le cas des « Malgré-Nous », c’est à dire celui des Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l’armée allemande au cours de la 2ème guerre mondiale. L’occasion m’est donnée par l’Association des Anciens Combattants de la Banque de France de vous proposer le récit authentique, hélas incomplet, de l’un de ces Alsaciens qui, en deux ans, a porté successivement les uniformes allemand, russe, anglais |
1 – ANNEXION DE L’ALSACE PAR LES ALLEMANDS |
Abandonnée par la FRANCE après la défaite de juin 1940, l’Alsace, proie facile et enviée par les Allemands, fut tout simplement annexée au « Gross Deutsche Reich » de Hitler. Après plusieurs interventions auprès de celui-ci, le Gauleiter Wagner, gouverneur régional de l’Alsace, obtint enfin l’accord de mobiliser et d’incorporer les Alsaciens dans la Wehrmacht par décret du 25 août 1942. Jour de honte et de colère en Alsace. Nombreuses furent les évasions en SUISSE et en zone occupée. La réaction des nazis fût brutale : menaces de mort pour les repris et déportation des familles concernées. Des représailles de toutes sortes étaient à l’ordre du jour. Dans un même village, 19 jeunes gens tentèrent l’évasion en SUISSE et furent arrêtés par les gendarmes. Le même jour, les 19 furent fusillés et rendus à leur famille. Les premières recrues refusèrent de porter l’uniforme allemand ; ils furent emmenés en camions à Schirmeck, camp de redressement non loin de Struthof où, la faim, les tortures et les mauvais traitements eurent raison de leur résistance ; l’envoi direct sur le front russe était la suprême punition pour ces rebelles. |
2 – MOBILISATION DANS L’ARMÉE ALLEMANDE |
J’avais 17 ans et demi en février 1943, en classe de terminale au lycée de Haguenau quand me parvenait l’appel au service prémilitaire. Durant 3 mois, nous étions en instruction aussi bien civique que militaire pour nous raisonner et nous inculquer la discipline militaire allemande. La même année, au mois de mai, je me trouvais porteur de l’uniforme « vert de gris » en Rhénanie. L’instruction du soldat allemand était particulièrement dure et variée. Une fois le cycle terminé, il n’y avait pour nous Alsaciens et Mosellans qu’une seule destination : celle du front de l’Est. Au mois de novembre je me trouvais avec 6 autres camarades alsaciens en première ligne sur le front central russe dans le secteur de Smolensk. Notre mot d’ordre était de nous évader dès que l’occasion propice se présenterait. Nous n’avions ni envie, ni raison de nous battre en soldat allemand contre un ennemi qui n’était pas le nôtre. De leur coté, les Russes ne chômaient pas et chaque nuit des haut-parleurs incitaient les Français à s’évader et à rejoindre leurs lignes où ils seraient bien accueillis. Sous la violence de l’artillerie russe, après plusieurs attaques infructueuses de l’infanterie, nous apprenions qu’un repli devait s’effectuer. A cette époque l’armée allemande était déjà sur la défensive. |
3 – ÉVASION POUR REJOINDRE LES RUSSES |
C’était le moment que j’avais choisi, avec un autre Alsacien, pour tenter notre évasion. En pleine nuit et profitant de la fatigue générale, au lieu de nous replier, nous avions pris la direction opposée vers un village que nous imaginions abandonné. Il s’y trouvait quelques civils qui s’empressèrent de nous héberger, vu que nous étions armés. Mon camarade d’évasion, parlant un peu la langue russe, leur fit comprendre que nous n’étions pas des Allemands mais des Français voulant se rendre aux troupes russes. Le lendemain matin les premières unités de l’armée soviétique, déjà prévenues par nos civils, nous ont accueillis avec de larges sourires et, nous tapant dans le dos, n’arrêtant pas de nous inonder avec des cris de « Frazouski karacho » ce qui veut dire : « C’est bien, les Français ». En voyant nos bouts de tissus tricolores, seules justifications de notre nationalité, ils éclataient de rire et les jetaient. J’ai eu l’impression que ces braves russes ignoraient absolument ce qu’était la FRANCE |
4 – PRISONNIERS DES RUSSES |
Après les premiers interrogatoires, fouilles et confiscations de tout ce que nous avions de personnel, nous étions menés, accompagnés de deux sentinelles, d’état-major en état-major et d’interrogatoire en interrogatoire, jusqu’au colonel. Pendant ce trajet, nous étions ainsi exposés à toutes sortes de mauvais traitements de la part des soldats russes montant au front ; des coups sous toutes les formes pleuvaient sur nous à cause de notre uniforme et les sentinelles avaient bien du mal à nous mener à notre destination. Lors de nos multiples interrogatoires, nous avions beau expliquer que nous étions des enrôlés de force, que nous étions des évadés de l’armée allemande et que nous souhaitions nous battre avec l’armée du Générale de Gaulle, la méfiance ou l’ignorance persistait dans leur esprit. Vint le jour où un capitaine de l’Armée Rouge nous soumettait, à son tour, mais en français, à ses questions. Il nous promettait que nous serions dirigés sur un camp de rassemblement des français et envoyés vers l’armée de De Gaulle. Mais dans l’immédiat, comme preuve de nos dires et de notre nationalité, il exigerait d’accomplir pour lui la mission suivante : l’un de nous, de préférence mon camarade parlant un peu le russe, devait s’infiltrer derrière les lignes allemandes et revenir, après espionnage, dans le camp russe. S’il refusait cette mission, il dit, sortant son pistolet, qu’il nous fusillerait tous les deux. Nous comprîmes, tout de suite, le sens suicidaire d’une telle aventure, connaissant l’extrême difficulté d’une telle opération et les risques énormes qu’elle comportait aussi bien dans un sens que dans l’autre. Nombreux furent les prisonniers allemands et alsaciens à être fusillés au moment de leur capture ou de leur évasion. Je n’ai jamais revu mon camarade ; sa famille, déjà éprouvée par la perte d’un fils tué au front, n’a jamais eu de ses nouvelles. Par malheur, le père de l’un de ces « Malgré-nous » s’est tué lors des opérations de déminage en 1945. Après cette séparation, je fus dirigé sur un autre groupe de prisonniers allemands, deux autrichiens et un polonais. Il nous fallait parcourir environ 300 km à pied dans la neige et la boue. Plusieurs jours durant, sans autre nourriture qu’un bout de pain sec, nous nous traînions misérablement à travers la campagne russe, froide et nue. Heureusement un petit camp transitoire était au bout de cette pénible marche. Aussitôt, en tant que français, je fus dirigé sur une baraque avec une quarantaine de compatriotes, belges et luxembourgeois. Quelle joie de retrouver des gens du pays ! Ils m’annoncèrent leur bonheur de partir enfin, dès le lendemain, vers le camp de rassemblement des français. Ils étaient dans un état physique lamentable, et, seul l’espoir de quitter ces lieux les faisait tenir debout. Leur chef, un Luxembourgeois, dut se bagarrer dur avec les autorités russes pour obtenir mon inscription sur la liste du convoi. Toute la nuit je passais, à nouveau, à l’interrogatoire, ayant provoqué la modification de leur « comptabilité ». Mais qu’importait, je n’avais nulle envie de rester seul avec les prisonniers allemands dans cet endroit où la chance de survie était quasiment nulle. Je ne peux m’empêcher de décrire la scène du seul repas la soupe. Elle était servie dans une cuvette à anses, aussi sale à l’extérieur qu’à l’intérieur. Ce liquide représentait la ration d’environ 20 prisonniers, réunis en cercle. Chacun avait droit à deux gorgées, et, croyez moi, une fois les deux mouvements accomplis, on se chargeait vigoureusement de vous arracher la « soupière ». C’était le tour du voisin et ainsi de suite. Le départ de ce camp eut effectivement lieu le lendemain comme prévu. Un grand traîneau, chargé de ravitaillement (des sacs de millet et de pain rassis), nous accompagnait à destination du fameux camp de rassemblement des Français. Pendant le voyage, nous avions droit de temps à autre à quelques morceaux de pain et à un seau d’eau où il fallait, avec une vieille boîte de conserve complètement rouillée, puiser quelques gorgées. Les sacs de millet embarqués au départ furent l’objet de troc, effectué entre les gardiens et les civils. Pendant les arrêts prolongés, il y en eut deux, nous étions dans un hall de gare; dans nos uniformes allemands nous étions exposés aux injures, menaces et crachats de la population civile qui avait tant souffert de l’occupant allemand. La nuit du 24 décembre nous fûmes parqués dans un sous-sol en béton de la gare d’Orel. Sans lumière, remplis de tristesse, nous pensions aux Noël de chez nous, quelques sanglots se faisaient entendre. |
5 – LE CAMP DE TAMBOW |
Enfin, le 28 décembre, on nous annonçait que nous étions arrivés à notre camp de rassemblement, celui de Tambow, ville située à 400 km au sud-est de Moscou. Pleins d’espoir et presque avec joie, nous avons traversé la forêt de 6 km qui nous faisait découvrir plusieurs rangées de barbelés, de miradors dans un éclairage surpuissant. A part une petite maison à l’entrée, nous n’apercevions aucun bâtiment et pour cause les baraques étaient enfouies sous terre. Après une heure d’attente, de palabres entre les divers responsables et une fouille générale en pleine nuit, les portes du paradis s’ouvraient…. Comptage et recomptage, sans boulier c’était pénible. Tiré par un cheval, un grand traîneau, chargé de cadavres entassés pêle-mêle, prenait la direction de la sortie du camp. Peu après, nous étions dirigés vers le sauna et la désinfection. Nous y apprîmes, par des coiffeurs improvisés, que c’étaient les morts du camp évacués ainsi et enterrés en fosse commune sous quelques branchages de sapin à l’extérieur du camp. Nous étions avides de renseignements quant à l’organisation du camp et à la manière d’y survivre. Très vite, nous nous rendîmes compte que les conditions de détention étaient lamentables. Logés dans des baraques en bois enterrées aux deux tiers avec une seule lucarne dans le toit comme source d’éclairage, nous dormions sur deux étages de bat-flanc de telle façon que si l’un se retournait toute la rangée devait faire le même mouvement. Il y avait des baraques à huit bat-flancs abritant jusqu’à quatre cents hommes à la fois. A côté de la porte d’entrée était installé un poêle qui devait chauffer la baraque. Il marchait uniquement au bois (vert le plus souvent), denrée qui abondait dans les environs. La fumée dégagée par cet engin envahissait souvent l’intérieur des baraques et le mélange avec l’humidité du sol en terre battue développait une odeur âcre et moisie, s’accrochant aux habits et aux habitants. Des parasites, tels que puces et poux, se plaisaient dans ce milieu et constituaient, à présent, nos ennemis les plus redoutables. Les conditions d’hébergement dans ce camp de rassemblement des Français étant plus que déplorables, nous espérions y trouver un ravitaillement et une nourriture à un meilleur niveau. Hélas, là aussi, ce fut la grosse déception pour ne pas dire la catastrophe…. Deux fois par jour, nous avions droit à un bol de liquide avec quelques feuilles de choux gelés. Après cette « soupe » et à midi seulement, en guise de plat de résistance, était servie une bouillie de millet, appelée « kacha », de la contre-valeur de deux cuillerées de soupe pour le volume. Le matin un morceau de pain ou ce qui du moins y ressemblait, nous était distribué. C’était en somme notre seul repas solide de la journée. Il n’y avait pas d’eau potable dans le camp ; la soupe restait le seul liquide absorbé pendant toute la durée de la captivité. Après une période de trois semaines et pour lutter contre la vermine, nous étions dirigés vers le sauna. Nos vêtements étaient soumis à une désinfection dans la vapeur. Pendant la durée de ce procédé, nous recevions à tour de rôle, dans une cuvette, l’équivalent de deux à trois litres d’eau chaude pour nous permettre de faire notre toilette et, éventuellement, laver un mouchoir pour ceux qui possédaient encore cet article. Nous nous séchions autour d’un poêle en fonte en attendant que nos vêtements nous reviennent. Cela n’empêchait pas nos parasites de proliférer. Dans de pareilles conditions, nous étions rapidement tombés physiquement et moralement à un niveau très bas. Les efforts à fournir dans les différents commandos de travail étaient pratiquement au-dessus de nos forces et de nos possibilités. Et, pourtant, grâce à des menaces et punitions, certains arrivaient à accomplir les normes prescrites par les Russes. Pour beaucoup les commandos des écluses, de la forêt, de la tourbe et la corvée de latrines en hiver étaient l’équivalent d’une condamnation à mort. Pendant les mois d’hiver surtout, sous des températures moyennes de moins 30°, les pertes en hommes ne cessaient de croître. Dysenterie, gelures, pneumonies et autres faisaient des ravages. A l’extrême limite de leurs forces, les malades étaient emmenés vers un hôpital, où pratiquement sans soins et médicaments très peu en réchappaient. Tous les matins les chefs de baraque devaient annoncer le nombre de morts décédés dans la nuit. Une moyenne de six à huit morts par baraque pendant ces mois de froid était considérée comme normale. Dépouillés de leurs vêtements, ils étaient entassés dans une baraque spéciale et, la nuit, le sinistre traîneau les ramassait pour leur faire franchir une dernière fois la porte du camp pour rejoindre les centaines, voire les milliers de leurs camarades dans la fosse commune. Personne n’a jamais su le nombre exact de ces victimes ; on a annoncé le chiffre de plus de cinq mille. Nul n’ira jamais fleurir ce coin de forêt perdu dans l’immensité russe où tant d’innocents reposent pour toujours, victimes de la faim, des souffrances, du froid, du désespoir pour une cause qui n’était pas la leur. Prisonniers pour toujours dans une terre étrangère qu’ils avaient espérée hospitalière et fraternelle. De nouveaux arrivants comblaient les vides de sorte que les effectifs du camp semblaient toujours à leur maximum, environ deux mille prisonniers. Survivre ainsi, dans un pays hostile, sans Croix Rouge, sans colis, sans aucune nouvelle, ne connaissant plus la date, ignorant l’heure du jour et le jour de la semaine, relevait presque de l’exploit ! Malgré les nombreuses demandes adressées par les dirigeants du camp, par l’intermédiaire du commissaire politique, au Généralissime Staline, notre espoir de sortir de cet enfer s’amenuisait de plus en plus. Et pourtant, le jour du débarquement des Alliés, le 6 juin, notre moral remonta. L’espoir d’une fin rapide des hostilités et, par là, notre rapatriement renaissait dans nos cœurs. Une tournure tout autre allait s’offrir à nous, du moins, pour mille cinq cents d’entre nous. Au cours de ce même mois de juin 1944, nous avons eu la surprise de la visite au camp de Tambow du Général Petit, attaché militaire à l’ambassade de Moscou. Une imposante délégation de civils et de militaires, dont le Général Petrov, passait en revue ces malheureux français presqu’oubliés. Dans un garde à vous rigoureux et dans un silence absolu, nous regardions avec fierté l’uniforme du général français, qui, sans un mot, regardait ces deux mille « Malgré nous » en haillons d’uniformes allemands. Nous aurions tant souhaité lui faire part de nos malheurs et de notre désir de sortir de là. Hélas, le « protocole » n’autorisait sans doute pas qu’un Français parle à d’autres Français sur cette terre étrangère. La délégation repartit, la déception et le désespoir s’installèrent à nouveau au camp. Au tout début du mois de juillet, le bruit d’un prochain départ du camp s’installait comme un événement sensationnel à travers nos baraques. Sceptiques et méfiants, nous avions du mal à croire pareille éventualité. Et pourtant voilà que mille cinq cents noms sont annoncés à l’appel. Ordre nous est donné de nous débarrasser de nos loques pourries en échange de l’uniforme russe, tout neuf. Il est impossible de décrire la joie qui envahissait le camp. Les mille cinq cents, les plus valides, parmi les deux mille prisonniers français allaient quitter ce cauchemar pour être rapatriés en France. |
6 – LE TRANSIT VERS L’ARMÉE BRITANNIQUE |
Le 7 juillet 1944, ce fut le grand départ de Tambow, en rang par trois, drapeau tricolore en tête, encadrés par quelques soldats russes, nous partîmes vers la gare de Tambow. Un dernier regard, non pas de nostalgie, mais vers ceux qui n’étaient pas jugés aptes physiquement pour le voyage. Leur seul espoir de survie s’évanouissait en nous voyant nous éloigner des barbelés. Parmi eux, très peu ont survécu et ont pu bénéficier du rapatriement suivant, en août 1945, donc, treize mois après notre départ. Sous la conduite d’un capitaine et d’une dizaine de sous-officiers français, l’embarquement dans les wagons fut rapidement effectué et toujours sous la surveillance armée des Russes. Ce fut un trajet long, fatiguant et pénible, mais nous débordions de bonheur. Heureux de quitter les conditions inhumaines de détention et de vie concentrationnaire du camp. Malgré le peu de contact avec l’escorte française, nous nous sentions déjà en semi liberté. La direction du convoi était plein sud, passant à Rostov, Krasnodar près de la mer Noire. Des arrêts fréquents, souvent de plusieurs heures, ralentissaient notre progression, et, aussi longtemps que nous n’avions pas quitté le territoire soviétique, une certaine appréhension nous habitait. Nous traversions la région du Caucase, avec l’Elbrouz en toile de fond, et Bakou au bord de la mer Caspienne. A partir de là, la sécurité du transport fut renforcée : des soldats soviétiques, mitraillette au poing, montaient sur la locomotive, précédée elle-même d’un wagon lesté de sacs de sable. Dans la région montagneuse de l’Azerbaïdjan une seule ligne de chemin de fer, souvent menacée et sabotée, conduisait, en effet, vers Tabriz, terme de notre périple en chemin de fer. Des camions militaires (G.M.C.), d’origine américaine, nous prirent en charge et nous menèrent dans des conditions épouvantables, après trois jours, à travers les hauts plateaux, aux abords de Téhéran. Nos conditions physiques, déjà peu brillantes au départ, ne s’étaient guère améliorées, au contraire ; les membres rompus par les innombrables cahots, dans des positions inconfortables au possible, l’estomac retourné par les soupes rances, seule nourriture pendant le voyage, le manque de sommeil. Tel était l’état des mille cinq cents volontaires venus de Russie pour combattre dans l’armée française. Voyant l’extrême fatigue des premiers débarquant des camions un médecin capitaine, chargé de nous accueillir, se précipitait au secours des deux premiers pour les soutenir, invitant les autres à le suivre. Comme un seul troupeau les 1.500 se ruèrent à la suite du médecin militaire, au grand regret et étonnement des Russes qui avaient l’intention de nous faire défiler avant de nous remettre à la délégation française |
7 – CONVALESCENCE ET RETOUR VERS LES TERRES FRANCAISES |
Quel bonheur enfin et quel soulagement pour nous tous d’avoir quitté définitivement le « paradis » soviétique et d’être à nouveau redevenus des « hommes » ! C’était le 22 juillet 1944, jour de mes 19 ans. Quel magnifique cadeau d’anniversaire. Jamais plus beau cadeau ne pourra m’être fait à l’occasion de mon anniversaire. Lors de la visite médicale, mon poids était alors de 39 kg. Partant de 80 kg au moment de mon incorporation, la cure d’amaigrissement s’avérait plus qu’efficace en dix sept mois. Le fait de savoir que désormais plus rien de semblable ne pourrait nous arriver, de savoir que nous étions à nouveau en contact avec des responsables ayant le souci de nous soigner et de nous guérir était hautement bénéfique aussi bien sur notre moral que sur notre état physique. Au repos complet, sous des tentes avec 50° de chaleur, notre organisme déréglé se soumettait sagement aux soins médicaux, sanitaires, à la nourriture et aux boissons adaptées à notre état. Au bout de huit jours, un résultat positif fut constaté pour le plus grand nombre des rapatriés. Malgré ces soins intensifs quelque trois cents de nos camarades présentèrent des troubles plus sérieux et durent être hospitalisés. Après ces quelques jours de convalescence et de réadaptation à une vie plus régulière, malgré la grosse chaleur régnant dans ce pays au mois de juillet, notre itinéraire de rapatriement se poursuivit. Revêtus dès notre arrivée à Téhéran de l’uniforme colonial britannique, convoyés dans des camions anglais, nous nous dirigeâmes vers la Palestine à travers le désert de Syrie en passant par Hamadan et Bagdad. Nous fîmes étape en plein désert dans un village de tentes britanniques où nous fûmes en admiration devant l’organisation et le confort existants. Notre convoi se dirigea ensuite vers Haïfa où nous attendait un autre camp de tentes sous les oliviers à proximité de la Méditerranée. Nous vivions à présent un rêve, le contraste si intense dans un temps relativement court, nous paraissait irréel. Trop longtemps plongés dans un total désespoir, nous réalisions avec peine l’extrême bonheur qui nous était offert. Nous restions sous surveillance médicale et bénéficions d’un régime de convalescence approprié, dans un climat merveilleux. C’était fantastique de se sentir renaître ! Nous serions tous restés quelques semaines de plus dans cet endroit charmant mais le but de la mission de rapatriement était de nous ramener en terre française. C’est ainsi qu’après trois semaines de repos nous avons embarqué Dans un convoi, escorté par des bâtiments de guerre, nous longeâmes la côte égyptienne, en particulier le port d’Alexandrie. Ces précautions étaient prises contre d’éventuelles attaques de sous-marins allemands. Une escale était faite à Tarente et deux jours plus tard le « Ville d’Oran » nous débarquait dans le port d’Alger. C’était le 29 août 1944. Une importante délégation militaire, musique, Croix Rouge, nous accueillaient sur les quais de débarquement. C’était l’unique fois qu’un contingent de français volontaires venant de l’Est était ainsi reçu et pour cause. Nous fûmes dirigés sur Maison Carrée en quarantaine. C’était là que le 2ème Bureau procédait aux enquêtes traditionnelles et à la mise à jour de nos situations. Quelques temps après, une dernière période de convalescence nous était octroyée à Tenes, petite ville en bordure de mer, où pendant trois semaines nous profitâmes du repos et d’une suralimentation. |
8 – LES COMMANDOS D’AFRIQUE ET CAMPAGNE D’ALSACE |
Ayant retrouvé, en grande partie, notre équilibre physique et moral nous étions à présent prêts pour rejoindre les diverses unités de l’armée française qui recrutait des volontaires. C’est ainsi que les « Commandos d’Afrique », unité de parachutistes et de choc était en quête de deux cents recrues. Il y en eut plus de six cents à se présenter. J’étais le cinquième sur la liste. A partir de là, une nouvelle vie commençait. Engagé volontaire pour la durée de la guerre, je partais dans ma nouvelle unité à Staoueli d’abord et ensuite en bord de mer dans une vieille forteresse du nom de Sidi-Ferruch. Faisant suite au chapitre précédent, celui de la captivité et du rapatriement, mais n’ayant plus rien d’exceptionnel ni d’insolite, voici succinctement le récit des événements vécus jusqu’à l’armistice. Engagé dans les commandos d’Afrique, sous les ordres du colonel Bouvet, et, portant à présent l’uniforme franco-américain, j’ai suivi la formation d’entraînement de parachutiste. L’instruction dans cette discipline fut, hélas, interrompue par le départ inopiné des Américains. L’enseignement des combats et des attaques surprises, spécialités des unités de choc, fut pratiqué quotidiennement à un degré très poussé. Dès le 17 novembre 1944, notre unité rejoignit la FRANCE où, à Aubagne, furent constituées les diverses sections. Fin décembre, c’était Belfort et dans l’attente de la bataille de Colmar nous étions cantonnés dans les Vosges. Faisant à présent partie de la 25ème division aéroportée, notre groupe fut désigné à percer l’accès sud de la poche de Colmar par l’attaque sur Cernay. C’était le 21 janvier 45, dans 45 cm de neige, sans camouflage, nous présentions des cibles idéales au bataillon de chasseurs bavarois, solidement installé en face de nous, abrité dans une forêt. Sous un violent tir de barrage de tous calibres, mais surtout de mortiers 88, les dégâts dans nos rangs s’avéraient inquiétants. Harcelés sur les flancs par des chasseurs bavarois, équipés de la tenue d’hiver et sur skis, nous étions menaces d’encerclement. Aussi la solution de se replier de ce terrain à découvert et de regagner la forêt, point de notre départ, fut-elle la plus logique. L’arrivée de blindés en renfort fut le signal de la contre attaque et, relativement protégé derrière les chars notre groupe gagnait à nouveau, du terrain. C’est à ce moment là que, marchant sur une mine en bois et malgré l’épaisseur de la neige, je fus gravement blessé. |
9 – BLESSURE, CONVALESCENCE ET RETOUR AU PAYS |
Transporté sur un char dans l’école de Burnhaupt, centre provisoire de soins, je me rendis compte que mon pied gauche avait été arraché. Je ne souffrais pas physiquement sur le moment, mais sachant que pour moi la guerre et, peut-être, ma vie se terminaient là, j’étais assailli par une multitude de pensées et de souvenirs : ma famille à 100 km de là, n’ayant eu aucune nouvelle depuis mon évasion sur le front russe, le film de mes souffrances en captivité, de notre libération etc. provoquant le coma. A mon réveil, et après plusieurs transfusions, j’ai été transporté en ambulance à l’hôpital d’Héricourt. Mal soigné et quasiment abandonné, j’ai eu la chance d’avoir été transféré après trois jours à l’hôpital américain de Besançon. C’est là que je fus opéré et soigné pendant un mois dans une atmosphère de propreté impeccable. Seul français parmi une cinquantaine d’américains, il m’est difficile, encore aujourd’hui, d’imaginer une qualité d’hébergement et de soins supérieurs à ceux dont j’ai profité pendant ces quatre semaines. J’en garderai le meilleur souvenir et une profonde gratitude envers ce personnel. Après cette période je faisais partie d’un convoi Croix Rouge de grands blessés de guerre à destination de Montpellier. Mon cas ne nécessitait plus de soins particuliers et j’étais autorisé à sortir. Durant mes deux mois de convalescence dans cette ville, j’ai vu et vécu ce que les habitants ont su apporter à « leurs » blessés. Inoubliable, la façon avec laquelle ces gens rivalisaient entre eux, à qui gâterait le plus et le mieux « son » blessé. Je leur garde ma plus profonde reconnaissance. Je fus libéré de l’hôpital de Montpellier pour le 1er mai 1945. Ma famille avait été prévenue, entre temps, de mon destin et attendait, avec impatience, mon retour. A mon arrivée il y a eu autant de larmes de joie que de compassion. Me voir revenir vivant après presque deux années de séparation et, sans nouvelles, et, me voir muni d’un pilon pour compenser J’ai été démobilisé en octobre de la même année. Il me fallait me réadapter à la vie civile et surtout envisager mon avenir. C’était alors, encore, la période où tout le monde fêtait la fin de la guerre et du grand cauchemar. Les bals, interdits pendant la guerre, constituaient la distraction essentielle. J’avais 20 ans… mais je n’étais plus jeune. Physiquement incapable de participer à ces réjouissances, je restais bien souvent seul et j’ai connu bien des moments de désespoir. Il est difficile et pénible de dire les ressentiments éprouvés quotidiennement. Se sentir incapable, inutile, abandonné, gêné, diminué en face de situations ignorées jusqu’alors constitue une épreuve terrible et plus douloureuse que la blessure elle-même. Et c’est le hasard qui fit? qu’un jour? je fus contacté par un voisin, alors contrôleur à la Banque de France, pour me proposer de me présenter comme candidat stagiaire à l’Institut d’Émission. J’y ai passé 38 années et j’ai le sentiment d’avoir rempli mon contrat et accompli mon devoir. Si ce récit peut avoir quelque valeur documentaire pour certains, je voudrais rappeler que bien des passages, évoquant des souvenirs douloureux, ont suscité des serrements de cœur et que c’est uniquement dans le but que l’Association des Anciens Combattants de la Banque voudra lui réserver que je l’ai rédigé. Qu’il serve à priori à l’information de certains mal renseignés, et que , surtout, nos générations futures, enfants et petits enfants, ne connaissent plus jamais pareilles folies. |