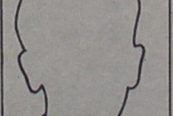Quand Marcel Weibel reçoit chez lui, il a déjà sorti la documentation complète. Son histoire est celle de bien d’autres, comme lui « incorporés de force ». Mais comme toutes les autres, la sienne revêt ses particularités, son cachet apporté par la personnalité forte de ce fidèle Sélestadien.
Tout commence à l’arrivée des Allemands. Le garçon a quatorze ans, ses parents tiennent un restaurant. Le ressentiment est fort, immédiat : « Les Allemands, ils n’étaient pas les bienvenus, on les haïssait. C’était l’ennemi. » D’ailleurs, à la maison c’est le mot « Schleuh » qui est utilisé, on n’en voit pas d’autre. « Les Français nous ont trahis quand ils sont partis, on n’avait plus le droit de parler la langue. »
Et pourtant, bien malgré lui, Marcel Weibel se retrouve impliqué dans une histoire dont il aurait tant souhaité rester éloigné, préférant les petits boulots qu’on lui proposait alors, à droite et à gauche. Dès 1941, alors qu’il n’a pas quinze ans, le garçon est convoqué par les autorités allemandes, le soir salle Sainte-Barbe.
« On nous a fait signer un papier, on n’avait pas le choix. On a signé, on ne savait pas ce que c’était. Le Schleuh nous l’a demandé, on l’a fait. » Quelques semaines plus tard, il reçoit un courrier. « J’ouvre, j’étais volontaire chez les SS ! » Il ne connaît pas trop les détails de ce corps d’armée multipliant alors les horreurs sur le front de l’Est. « On savait sans savoir ce que c’était. Mais ce que cela représentait, c’était terrible. »
S’il ne comprend pas comment il a pu se retrouver ainsi enrôlé, il ne sait pas plus pourquoi il a été placardé « pas acceptable ». La Waffen SS, il n’en voulait pas, elle se refuse à lui. La situation est cocasse, il imagine qu’on a mené une enquête familiale, avec cet oncle alors militaire au Maroc, dans l’armée française donc.
L’histoire ne s’arrête pas là : Marcel Weibel est à nouveau convoqué, cette fois du côté de Saint-Georges, « où il y avait l’état civil ». « Derrière moi, dans une file, il y avait un gars qui disait : « Je ne veux pas aller chez les SS, je ne veux pas aller chez les SS ». J’ai pris la porte de côté et suis sorti par-derrière. Je me suis enfui et suis rentré à la maison. » Mais on n’échappe pas à son destin aussi simplement : il est à nouveau convoqué, sommé de signer. « Je ne savais pas ce que c’était. J’ai dit : non, je ne signe pas ! Je n’avais pas dix-huit ans, ils ne pouvaient pas me forcer. »
Il s’en va libre encore, avec cette promesse qui fait froid dans le dos : « On vous aura quand même chez les SS ! » Quand, en 1944, il rejoint l’aviation, sous l’uniforme allemand, sans prévenir ni se douter, il est conduit en Tchécoslovaquie. « Là, je me retrouve sous l’uniforme SS. Ces salauds, ils ont finalement réussi à m’y faire rentrer ! » Une règle de conduite s’impose à lui d’emblée : « Je cherchais à sauver ma vie avant de rentrer à la maison. Ces gars-là, les SS, ils étaient haïs par tout le monde, ils ne faisaient jamais de prisonnier. Se faire prendre en tant que SS, c’était risqué la même chose. Alors moi, j’avais toujours un pistolet armé au cas où. Je ne voulais pas me laisser prendre. »
La fin de la guerre n’est pas loin, sur le front le soldat Weibel le sent bien. Sa principale préoccupation est alors d’être fait prisonnier par les Américains plutôt que par les Russes. Ces derniers se montrent sans pitié après avoir subi tant de massacres à l’avancée allemande. « Avec eux, je ne serais peut-être pas là. Nous, on attendait les Américains. Quand ils étaient en face, on n’a pas tiré. On attendait. J’étais dans une grange. Puis je me suis dit que cela suffisait, je suis sorti (pour se rendre), sans savoir ce qui m’attendait… »
Il est libéré en août 1945, « certains ont dû attendre neuf mois de plus, je ne sais pas pourquoi ». Lui mise sur « la chance ». « Un matin, au rassemblement on dit : « La lettre W sortez du rang ». Peu après, on nous a laissés partir : « Débrouillez-vous. » » Sur le chemin du retour, l’Alsacien croise des soldats français, commence en toute franchise à parler avec eux, puis il s’arrête. « Ils pourraient croire que j’étais volontaire, un Waffen SS volontaire. Il y en avait pas mal qui l’étaient ! »
En train de marchandise et en uniforme de prisonnier, Marcel Weibel rejoint Karlsruhe puis Strasbourg. « Nous étions à la maison, libérés. » Après un tour au centre de rapatriement au Wacken. Le soir, il prend le train pour Sélestat. « Je faisais 46 kilos, j’avais du mal à rentrer dans les habits de civil qu’on m’a donnés. À Sélestat, j’ai vu ma tante et ma mère, par hasard. Elles attendaient ma cousine qui venait de Paris. J’appelle « maman », personne ne réagit. J’appelle encore puis encore. Ma tante dit : « Mais c’est donc Marcel… » » La vie reprend, il ne parlera plus jamais de cet épisode, jusqu’au aujourd’hui. « C’était terminé. Vous arrivez à comprendre, vous, toute cette histoire ? Moi non. C’était ma vie, il fallait que je passe par là. »
Pendant moins d’un an, le désormais Waffen SS Weibel mène la guerre à l’Est, en pleine débâcle de l’armée allemande. L’Alsacien fait partie des Wikings, un régiment de panzerdivision. Au poste de pionnier, il fait ainsi partie de ces soldats employés aux travaux de terrassement. Il combat surtout en Pologne, en Hongrie aussi : « C’était meilleur, il y avait de grandes fermes, avec du lard salé, du lard fumé, du pain noir, du pain blanc et tout ça. »
Malgré quelques contre-attaques, son régiment est sur le reculoir. « On a surtout passé notre temps en retraite. » Une fois en Pologne, il est blessé, à la colonne vertébrale. « Les Russes étaient à 50 m. Le gars à côté se fait tuer par un franc-tireur, puis un autre. On reçoit l’ordre de rester sur place. Moi j’en avais marre, je me barre. À la moitié du chemin, ça commence à tirer, je me couche. D’un coup je sens quelque chose. Je mets la main, il y a du sang. Je continue à courir… »
À l’hôpital, en Autriche, on le trouve sale. « Cela faisait des mois que je ne m’étais plus lavé : le matin on prenait de la neige dans les mains et on faisait ça et ça (il fait mine de se passer la neige sur le visage, en deux gestes). » Soigné, il est renvoyé sur le front. Où il réchappe à une mort promise. « Un soir, je me retrouve entre deux chars (allemands), je me couche dans une tranchée pleine de neige et commence à ronfler. Le matin, les copains étaient partis, les chars avec. Nous n’étions plus que quelques-uns, on n’avait rien entendu. Quelle direction prendre ? Il y avait du brouillard. D’un coup on voit des chars russes. Que faire ? Grâce au brouillard, on a pu passer entre deux chars, en rampant. En arrivant dans une forêt, on tombe sur une unité allemande. Pendant la guerre, on ne se rend même pas compte de ce qu’on peut faire pour se sauver la vie ! »