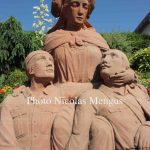ALLAINMAT Henri, Auschwitz en France, Paris, 1974.
020. Les « Malgré-Nous » à Oradour…
Les « Malgré-Nous » à Oradour…, Spécial dernière, 213, 1973, p. 2–3, 6.
010. L’enfer des « Malgré-Nous »
L’enfer des « Malgré-Nous ». Spécial dernière, 210, 1973, p. 2–3.
040. Le soldat honteux. « J’étais un Malgré-Nous »
ZAHNER Armand, Le soldat honteux. « J’étais un Malgré-Nous », Mulhouse, Paris, Tournai, 1972.
030. Paul Munier, martyr de la résistance à l’incorporation de force
WETZEL Raymond, Paul Munier, martyr de la résistance à l’incorporation de force, L’Almanach du
combattant, 1972, p. 51.
020. Les dommages physiques et psychiques chez les internés
THUET Jean, Les dommages physiques et psychiques chez les internés, rescapés du camp de Tambow,
Mulhouse, 1972.
010. Carnet de route d’un incorporé de force
SCHARF Emile, Carnet de route d’un incorporé de force (21 articles parus dans les DNA, septembre-
octobre 1972), 1972.
030. L’incorporation de force
L’incorporation de force, Saisons d’Alsace n°39/40, été-automne 1971.
020. Un Alsacien de 17 ans sur le front russe
SAJER Guy, Un Alsacien de 17 ans sur le front russe, Historama n°238, 1971.
010. L’Alsace dans les griffes nazies
BENE Charles, L’Alsace dans les griffes nazies, t. I-VII, Raon-L’Etape, 1971–1988.