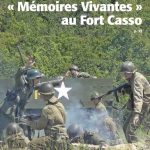Lettre ouverte à Monsieur Jean-Yves Le Drian,
Ministre de la Défense
Le 17 mars 2015
Monsieur le Ministre,
Le Ministère de la Défense a accordé son soutien au documentaire « Das Reich » diffusé le 2 mars 2015 sur France 3.
Nous, historiens, auteurs, chercheurs, témoins de ce temps de l’annexion de l’Alsace ainsi que de l’incorporation de force et leurs enfants, nous nous élevons vivement contre ce documentaire.
En effet, nous considérons qu’outre un nombre d’erreurs et d’approximations inacceptables, ce documentaire présente une vision erronée et offensante pour la mémoire de l’Alsace.
L’amalgame criant fait entre le soldat allemand et le soldat alsacien, l’affirmation répétée de la présence majoritaire des Alsaciens dans les divisions Waffen-SS, l’absence de précisions concernant les conditions de l’enrôlement des incorporés de force, aboutit à une vision de l’histoire qui met à mal plus de cinquante ans de recherches et de publications.
Il va sans dire qu’un tel propos ranime des douleurs anciennes et choque considérablement les mémoires.
Nous vous prions de bien vouloir exercer votre autorité afin que ce documentaire soit corrigé.
Veuillez croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de notre respectueuse considération.
Les signataires :
Monique Adler, enseignante (e.r.), conférencière, fille d’incorporé de force.
Serge Amorich, délégué national de l’Association des anciens incorporés de force dans le RAD et KHD d’Alsace et de Moselle.
Jocelyn d’Andlau-Poux, docteur en Psychologie Clinique, fille de Roland d’Andlau-Hombourg, Malgré-Nous, évadé et médaillé en tant que résistant, nièce d’Hubert d’Andlau-Hombourg, historien, 1er prix d’histoire de l’Académie Française et auteur de « Seul dans la tempête », arrière-petite-fille d’Hubert d’Andlau-Hombourg, sénateur du Bas-Rhin de 1928 à 1940.
Nicole Aubert, SNIFAM (Solidarité Normande aux Incorporés de Force d’Alsace-Moselle).
Robert Bach, classe 1922, incorporé de force engagé en Laponie.
Albert Baradel, classe 1926, Alsacien francophone du Bonhomme (Haut-Rhin). Est incorporé de force en avril 1944 dans la division Waffen-SS « Reichsführer-SS » et engagé en Italie. Evadé le 17 juin grâce à l’aide de résistants italiens avec lesquels il a opéré pendant 3 semaines. N’a porté l’uniforme SS que 52 jours. Réussit à rejoindre les lignes américaines et s’engage volontaire au Corps Expéditionnaire français en Italie.
Marie Laure de Barry, fille du général de Barry de 1980 à 1981 gouverneur militaire de Strasbourg et de la Première Armée.
Alexandre Berbett, adjoint au maire de Dannemarie, historien et petit-neveu de Malgré-Nous.
Linda Bergmann-Pfister, Alsacienne et fille de Malgré-Nous.
Pierre Bernard, Alsacien, enseignant retraité.
Victor Beyer, inspecteur général des Musées de France (en retraite). Classe 1920. Soldat français en 1940. Enrôlé de force dans la Wehrmacht, engagé en Istrie (ex Yougoslavie). Prisonnier des partisans yougoslaves, arrivé à Belgrade, par avion à Naples. Débarqué à Marseille sur le Duguay-Trouin. Démobilisé à Chalon-sur-Saône.
Jean Bézard, SNIFAM (Solidarité Normande aux Incorporés de Force d’Alsace-Moselle).
Pierre Biehl, maire de Bergheim, conseiller général du Haut-Rhin, fils d’un incorporé de force classe 1922.
Charles Bilger, président de l’Association des Alsaciens de Grande-Bretagne.
Charles Bohnert, fils d’un incorporé de force dans la Wehrmacht, historien et chercheur sur le drame des refugiés Alsaciens-Mosellans durant la période 1939–1945, participation à plusieurs ouvrages et conférences, secrétaire-adjoint de l’association nationale « Pour une Histoire Scientifique et Critique de l’Occupation (HSCO) ».
Maurice Brugger, Officier de réserve, adjoint au maire de Colmar.
Irène Burg, fille de Charles Burg arrêté par la Police de sécurité allemande et envoyé sur le front Russe, prisonnier à Tambov d’où il est revenu avec bien des séquelles.
Gérard Cardonne, écrivain engagé pour la défense de l’Alsace (« La bague de Riquewihr », « 2000 ans d’Alsace », « Franziska, l’Alsacienne », « Monte-Cassino » « Devenir Alsacien », « Devenir rhénan » à paraître).
Christophe Carmona, illustrateur, passionné d’Histoire et sympathisant à la cause des incorporés de force.
Marie-Laure de Cazotte, écrivain (« A l’ombre des vainqueurs », Albin Michel, 2014), petite-fille de George de Latouche, Alsacien, officier d’Etat Major du Colonel de Gaulle en 1939, propriétaire de la demeure qui servit de QG d’où le général Léclerc commanda l’attaque de Saverne et l’assaut victorieux de Strasbourg.
Gabrielle Claerr-Stamm, présidente de la Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace.
Marcel Claus, fils d’incorporé de force mort à Tambov en 1944.
André Clauser, fils d’incorporé de force alsacien, prisonnier à Tambov, libéré à l’automne 1945, décédé en 2013, défenseur du devoir de Mémoire.
Martin Deutsch, pasteur, fils de Georges Deutsch né en 1908, soldat français 1939–40 dans le 42e RIF. Fait prisonnier le 19 juin 1940, puis libéré comme Alsacien. Il est incorporé de force le 10.11.1941, comme beaucoup des classes 1908 à 1911, dans le Polizei Gebirgsjäger Regiment n° 18 avec lequel il est engagé en Finlande et en Grèce. Il est fait prisonnier des partisans yougoslaves qui le font marcher jusqu’à Belgrade. De là, des avions français l’amènent à Naples. Il est démobilisé à Châlon-sur-Saône.
Joseph Dietrich, classe 1922. Incorporé de force dans la Wehrmacht, engagé en Ukraine en juin 1944, bloqué en Prusse Orientale, essai avorté d’évasion le 15 avril 1945, puis réussite. Camp de prisonnier à Tilsit. Retour le 25 Septembre 1945 par Valenciennes.
Marlène Dietrich, présidente de « Pèlerinage Tambov », dont le père est mort à Tambov le 3.5.1945.
Chantal Durlewanger, fille de résistant, déporté, Malgré-Nous et qui a fini la guerre sous uniforme français en libérant l’Alsace jusqu’en Allemagne en 1944–1945.
Hubert Durlewanger, fils d’incorporé de force alsacien, défenseur du devoir de mémoire.
Marie-Claire Durlewanger, belle-fille d’un Malgré-Nous
Philippe Edel, président de l’association Alsace-Lituanie.
Dr Georges Yoram Federmann, président du Cercle Menachem Taffel.
François Fenninger, président du Musée de l’Abri Ligne Maginot, maire de Hatten.
Paul Finance, enrôlé de force dans la Wehrmacht en Normandie, évadé le 3 août 1943, repris et condamné à mort pour désertion au Kriegsgericht le 2.9.1943 situé à l’Hôtel Continental, rue de Rivoli. Après huit semaines dans la cellule des condamnés à mort à Fresnes, sa peine est réduite à 10 ans de travaux forcés dans un bataillon disciplinaire sur le front russe. Blessé en Ukraine le 4.7.1944 et gracié le 6.9.1944, il retrouve son unité à Müllheim (Bade), puis il muté à Mulhouse d’où il s’évade une deuxième fois, le 21 novembre 1944, pour s’engager dans la 1ère Armée Française.
Daniel Fischer, classe 1926, incorporé de force dans la Division Waffen SS « Das Reich ». Engagé en Normandie, évadé le 30 Septembre 1944 à Malmedy (Belgique).
Elise Fischer, romancière (« Villa Sourire », Calmann Levy ; « Les larmes et l’espoir » écrit avec Geneviève Senger, Presses de la Cité).
Fernand Foeglé, orphelin de guerre.
Danièle Girel, Alsacienne, membre de Culture et Bilinguisme d’Alsace et de Moselle, » René Schickele Gesellschaft « , à Strasbourg.
Marie Goerg-Lieby, journaliste.
Thierry Gloris, scénariste.
Aline Gross-Batiot et son époux, belle-fille et fils d’incorporé de force, lectrice de lettres de « Malgré-Nous » dans le cadre de son spectacle « Je t’écrirai de là-bas ».
Jean-Marie Grunelius, conseiller municipal de Kolbsheim, administrateur de la Société des Lecteurs du Monde.
Roland Gutleben, orphelin de père incorporé de force mort en Russie, vice-président de l’Apoga et porte-drapeau.
Henri Hagenbach, incorporé de force dans la Division Waffen-SS « Reichsführer SS » et engagé en Italie. A été présent à la pendaison, le 18 août 1944, de ses camarades alsaciens Zimmermann et Kreutter ; nous ne les oublierons jamais !
Jean-Claude Hahn, historien, président honoraire de la Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace.
Jacques Halb, médecin, Wehrmacht en Russie 1943–44. Mutilation volontaire des deux jambes. Engagé en Normandie en juillet 1944. Evadé et engagé volontaire dans la 2ème Division Blindée avec laquelle il rentre à Paris.
François-Xavier Hartmann, incorporé de force dans la Waffen-SS, division « Reichsführer-SS« , dont il s’évade en Toscane le 12 juillet 1944.
Jean Haubenestel, historien.
Jean-Marie Heinrich, fils de déporté et incorporé de force.
Marianne Hentzler, épouse Jean-Paul Helburg, fille de Malgré-Nous.
Claude Herold, chercheur qui compte neuf incorporés de force dans sa famille, dont sept ne sont pas revenus.
Daniel Hoeffel, ancien ministre, témoin de la période.
Jean Hueber, fils de Jean-Alfred Hueber mort à Morschansk en 1944.
André Hugel, témoin et historien (auteur de plusieurs ouvrages dont « Entre deux fronts. Les Alsaciens incorporés de force dans la Waffen-SS« , Pierron, 2007–2008).
Jean Hurstel, historien, collaborateur à de nombreuses publications.
Marie Janot Caminade, doctorante sur le thème de « La mémoire collective de l’incorporation de force ».
Alphonse Jenny, ancien maire de Kintzheim (Bas-Rhin), professeur agrégé, historien, témoin.
Guillaume Joseph, journaliste-artiste.
Chantal Kaiser, nièce d’André Heck, revenu de Tambov à l’automne 1945.
Gilles Kalck, fils d’incorporé de force.
Patrick Kautzmann, chercheur, spécialiste de la Roumanie, Hongrie et Moldavie.
Marlène Keck-Jung, dont le père est décédé à Tambov le 3 septembre 1944.
Eugène Kennel, incorporé de force, chauffeur dans la 1er compagnie du régiment « Der Führer » de la division Waffen-SS « Das Reich« .
Richard Klein, petit-fils de résistant déporté.
Laurent Kleinhentz, historien.
Brigitte Klinkert, vice-présidente du Conseil Général du Haut-Rhin.
Michel Klausser, fils de Malgré-Nous, ancien maire et conseiller général, et chevalier de l’ordre du Mérite.
Jacqueline Knecht-Mosser, vice-présidente du Souvenir Français – comité de La Robertsau.
Thierry Kranzer, secrétaire général du Comité des Associations Francaises de New York.
Willi Kuhlmann, Alsacien, patron de PME.
Gérard Laïb, chercheur.
Pascal Landry, sympathisant à la cause des Malgré-Nous.
Bernard Le Marec, professeur de médecine (hon) à Rennes. Auteur de « L’Alsace dans la guerre 1939–1945 ».
Régis Le Sommier (« Les mystères d’Oradour. Du temps du deuil à la quête de la vérité », Michel Lafon, 2014).
Francis Lichtlé, historien.
Bernard Linder, historien.
Jean-Pierre Luttringer, fils d’un incorporé de force.
Salomé Lux, avocat à la Cour, Paris, fille de Richard Lux, un des défenseurs des Malgré-Nous au procès de Bordeaux en 1953.
Christine Mann, nièce de Malgré-Nous, Colmar.
Michel Matter, retraité de l’administration pénitentiaire, fils de Jules Matter, déporté politique, neveu de Théophile Matter, incorporé de force décédé en 1944, et neveu de René Poirel, résistant.
Jean-François Mattler, vice-président de la Fédération Démocratique Alsacienne.
André Mehr, neveu de l’incorporé de force dans la division Waffen-SS « Das Reich » Rohrbach, tombé le 7 juillet 1944 près de La Haye du Puits (Manche).
Christiane Mengus, fille d’incorporé de force dans la Waffen SS.
Claude Mengus, neveu d’incorporés de force.
Nicolas Mengus, docteur en Histoire (auteur de nombreux articles et ouvrages dont « Entre deux fronts. Les Alsaciens incorporés de force dans la Waffen-SS« , Pierron, 2007–2008 ; www.malgre-nous.eu), petit-fils d’un déserteur du Volkssturm, d’un réfractaire à l’incorporation de force, neveu et petit-neveu d’incorporés de force dans la Wehrmacht et la Waffen-SS, proche parent d’un déporté politique.
Christine Meyer, auteur de « L’oncle retrouvé », nièce de Malgré-Nous.
Freddy Meyer, chercheur.
Hubert Meyer, né en 1924, incorporé de force, se rappelle son retour de Tambov, en octobre 1945.
Angèle Miss-Stéphan, citoyenne française d´origine alsacienne.
Marie-France Montavon, au nom de son oncle Julien Pettermann, né en 1919 à Châtenois (Bas-Rhin) et mort à l’hôpital de Kirsanov.
Simone Morgenthaler, journaliste-écrivain (« Pour l’amour d’un père, les moissons de la mémoire », éditions du Belvédère).
Ulrike Muller, allemande de naissance, belle-fille d’un incorporé de force alsacien rescapé de Tambov.
Yves Muller, classe 1927, ancien Luftwaffenhelfer, président de l’ADEIF du Haut-Rhin, secrétaire général de la FEFA.
Danièle Neunreiter, fille d’un incorporé de force dans la Kriegsmarine.
Paul Nüsslein, adjoint au maire de la commune d’Oermingen et président de la Société de Recherche Archéologique d’Alsace Bossue.
Gérard Obringer, président fondateur de la Fédération française des chambres régionales du surendettement social (CREDIS).
Erica Oster, orpheline d’incorporé de force.
Louis Oster, avocat actif en janvier-février 1953 lors du procès de Bordeaux sur Oradour.
Walter Oster, orphelin d’un incorporé de force dans la « Das Reich » mort en Normandie.
Pierre Pancrazi, auteur du livre « Les deux grands-pères ».
Raymond Piela, auteur-graphiste.
Eve Pitovic-Lorentz, alsacienne, conférencière (Tambov, annexions de 1870 à 1945), artiste peintre. Fille de Georges Lorentz, enrôlé de force dans la Werhmacht, fait prisonnier par les Russes sur le front de l’Est. Captivité à Tambov et retour en août 45. Trois cousins maternels décédés en Russie, bataille de Koursk. In Memoriam, Monsieur Albert Spehner, de Strasbourg, Malgré-Nous, pour son soutien dans mes recherches, et le devoir de mémoire.
Lise Pommois, historienne de la 7e Armée américaine.
Charles Putz, directeur de recherches à l’INRA (er), historien.
Francis Rapp, né en 1926, prévu sans doute pour la Waffen-SS, a évité l’incorporation par des traitements médicaux dangereux. Professeur d’Histoire (er), témoin de cette époque.
Jean-Luc Reitzer, député
Jean-Joseph Ring, professeur e.r., fils de Eugène Joseph Ring, incorporé de force en novembre 1944, porté disparu sur le front russe en décembre 1944.
Jean-Michel Ritter, président d’honneur de la Fédération Démocratique Alsacienne.
Bernard Rodenstein, président d’honneur de l’Association des Pupilles de la Nation, orphelins de guerre d’Alsace (APOGA), président de la Fédération des Pupilles de la Nation (FPN).
Christiane Roederer, présidente de l’Académie des Sciences, Lettres et Arts d’Alsace.
Emile Roegel, témoin de l’époque, a séjourné de longs mois au camp soviétique de Tambov.
Henri Rubly, classe 1926, est parti aux Waffen-SS le 17 avril 1944 pour le Heidelager près de Cracovie, puis à Debrecen en Hongrie où a lieu l’entraînement militaire. Muté à la division Waffen-SS « Reichsführer SS » en Italie, au sud de Pise. S’évade le 17 juin 1944, avec d’autres Alsaciens dont A. Baradel, vers des résistants italiens. Une embuscade allemande cause la mort d’un d’eux : Charles Greder. Le 8 juillet, caché dans la nature, il arrive à rejoindre les combattants américains. Passant par le camp de Naples, il s’engage volontaire au Corps Expéditionnaire français et passe en Algérie.
Julien Rudloff, enseignant d’histoire (e.r.), historien.
Jean-Michel Rudrauf, médiéviste, fils d’incorporé de force.
Charles Sandrock, fils de Joseph Sandrock, né en 1912 est mort le 9.2.1945 à Tambov.
François Schaffner, historien, professeur (e.r.).
Paul Scheeg, fils de Marcel Scheeg, mort à Orscha à l’automne 1945, lors du voyage de retour de Tambov en France.
Yves Scheeg, ingénieur, à la recherche la tombe de son grand-père, mort pour la France, soldat français (1936–1938 puis 1939–1940), déporté militaire par Hitler (1943–1944) et interné par Staline (1944–1945), mort de malnutrition sur le chemin de la liberté en septembre 1945.
Clément Schmitt, master 1 en histoire de l’Alsace à l’Université de Strasbourg.
Joseph Schmittbiel, traducteur et auteur du site hewwemi.net.
Roland Schmitthaeusler, secrétaire de l’association Orphelins de Pères Malgré-Nous d’Alsace-Moselle.
Gabriel Schoettel, écrivain, agrégé de Lettres.
Gérard Schutz, parent de Malgré-Nous mosellans.
Pierre Seltz, viticulteur, historien, fils de soldat français 1939–1940 et résistant 1941 –1944.
Maryline Simler, documentaliste, co-auteur du livre Lettres de Malgré-Nous.
Sophie de Sivry, directrice des Editions de l’Iconoclaste, Paris.
Michèle Storck-Leiser, fille d’un Malgré-Nous.
Sophie-Elisabeth Syring, fille de Désiré Eiller, soldat français 1939–40, incorporé de force dans la Wehrmacht en URSS, prisonnier de longs mois au camp de Tambov.
Marcel Thomann, professeur (em.) de la Faculté de Droit de Strasbourg, président d’honneur de la Fédération des Sociétés d’histoire et d’archéologie d’Alsace, historien.
Denis Trierweiler, journaliste.
Alphonse Troestler, délégué à la Mémoire pour la Région Alsace (2008–2014).
Bernard Vogler, historien.
Pierre Vonau, historien.
Jean Weber, inspecteur général des Finances honoraire, ancien président du CIAL, président d’honneur fondateur du « Cercle de l’Ill », petit-fils de déporté mort pour la France, passeur de Malgré-Nous.
Jean-Jacques Wehrung, fils d’Édouard Wehrung, Alsacien engagé volontaire dans l’Armée Française en 1939, prisonnier des Allemands en 1940, incorporé sous la contrainte dans la Wehrmacht en 1943, évadé de la Wehrmacht sur le front de l’est, fait prisonnier par les russes et enfermé à Tambov jusqu’en octobre 1945.
François-Xavier Weibel, fils de Malgré-Nous.
Richard Weiss, président-fondateur de l’Association de parents d’élèves pour le bilinguisme dès l’école maternelle (ABCM).
Etienne Wessang est incorporé de force, à 16 ans, dans le Reichsarbeitsdienst et quitte Ingersheim le 19 novembre 1944 avec 300 jeunes de la région. Il part en Prusse orientale où, peu après, il passe à la Wehrmacht. Engagé au front qui bat en retraite, il traverse les eaux glacées entre la terre et la Baltique. Avec des milliers de civils, il réussit à passer de Pillau au Danemark où ses deux avant-pieds sont amputés. Il rentre à Ingersheim le 5 octobre 1945, il n’avait que 17 ans et 1 mois.
Philippe Wilmouth, président de l’Association pour la Conservation de la Mémoire de la Moselle en 1939–1945, docteur en Histoire, auteur de « Mémoires parallèles. Moselle-Alsace de 1940 à nos jours. L’annexion de 1940–45 / Les Malgré-Nous / Le procès de Bordeaux », Serge Domini Éditeur, 2012.
Christian Wilsdorf, témoin de l’époque, historien. Frère de Paul Wilsdorf, classe 1924, condamné à 6 ans de travaux forcés pour essai d’évasion vers la France occupée. Passé par le Fort Zinna à Torgau – puis bataillon disciplinaire en Russie. Evite d’être fait prisonnier par les Russes et atteint les combattants anglais.
Armand Wisselmann, classe 1923, incorporé de force dans la Wehrmacht près de Leningrad début 1943. Recule vers la Prusse orientale d’où il s’évade le 13 avril1945. Prisonnier dans un camp à l’Oural. Frère de Joseph, né en 1926, incorporé de force dans la Division Waffen SS « Das Reich » dans le Sud-Ouest, grièvement blessé dans les Balkans en novembre 1944, il retrouve l’Alsace en juillet 1945, engagé volontaire en Indochine.
Bernard Wittmann, historien (« Une Histoire de l’Alsace, autrement », 3 tomes, Rhyn un Mosel,1999 ; « Dictionnaire des communes d’Alsace » en français, allemand, alsacien, Est-Impression éditeur, 2006 ; « Südtirol-Alsace/Elsass – Histoires croisées », éd.Nord Alsace, 2010 ; « Jean Keppi – Une histoire de l’autonomisme alsacien », éd. Yoran Embanner, 2014.
Astrid Zaessinger-Roth, dont le père est décédé à Tambov en 1944.
Alain Zielinger, petit-fils, fils d’Alsaciens. Chevalier de l’Ordre National du Mérite.
Colonel ® Norbert Zorn, cérémonie patriotique du 29 avril 2015 à l’abbatiale de Marmoutier, pour le « devoir de mémoire » des 42 officiers alsaciens morts pour la France pour refus d’intégrer la Waffen-SS.
Lire l’article
 Je suis à la recherche d’éléments concernant mon oncle qui a été enrôlé de force par l’armée allemande : STEIB Paul Joseph Isidore, né le 21.09.1920 à Strasbourg (67), fils de STEIB Isidore et BEICHELT Félicité.
Je suis à la recherche d’éléments concernant mon oncle qui a été enrôlé de force par l’armée allemande : STEIB Paul Joseph Isidore, né le 21.09.1920 à Strasbourg (67), fils de STEIB Isidore et BEICHELT Félicité.